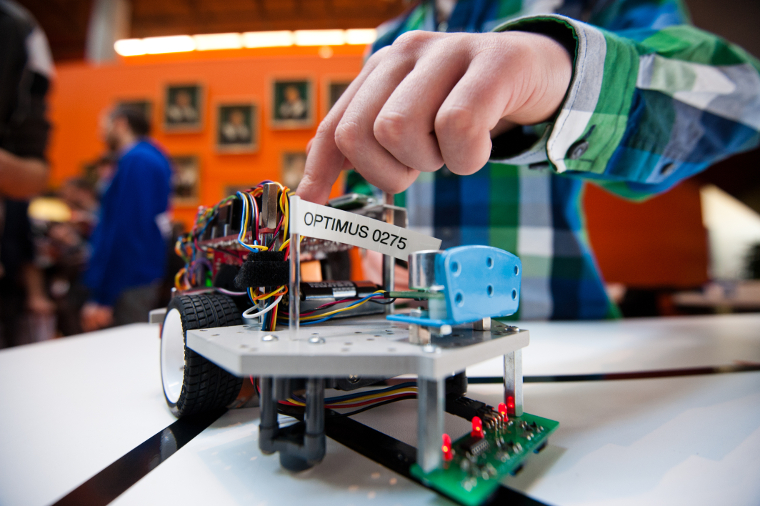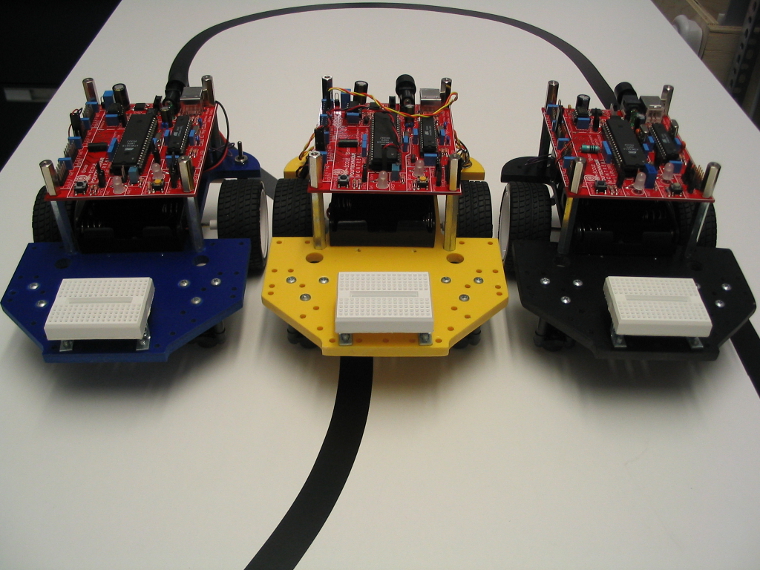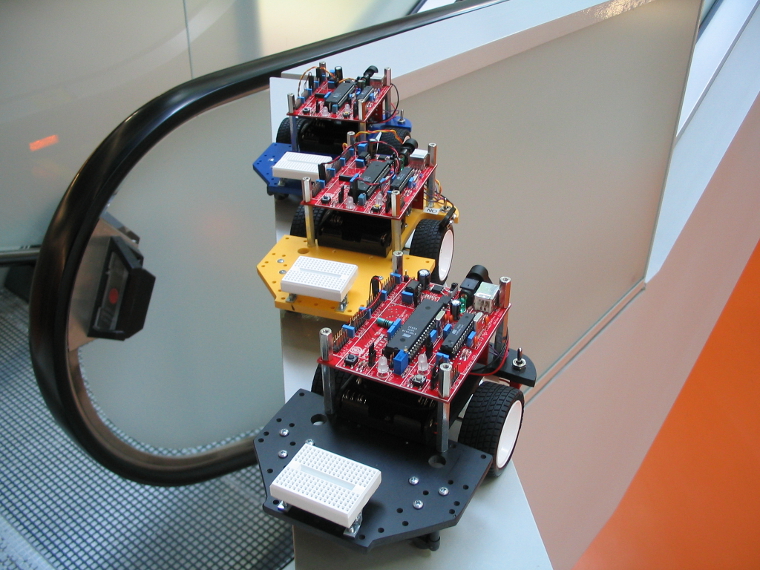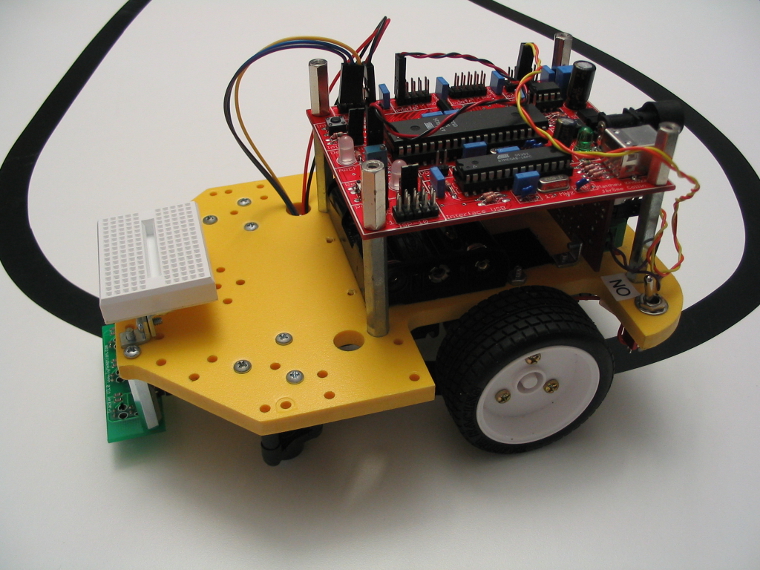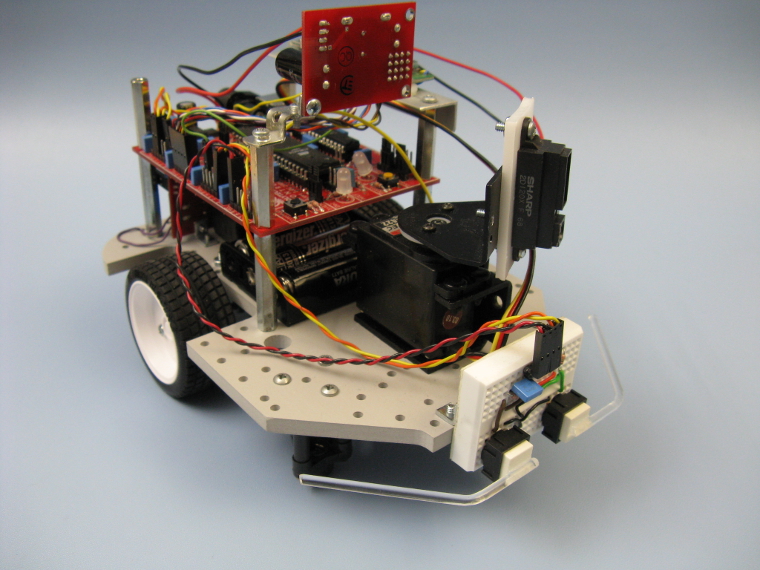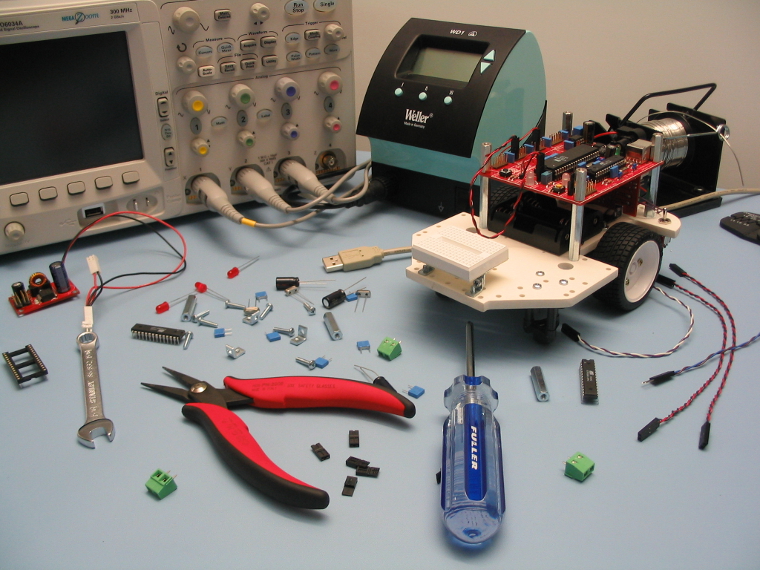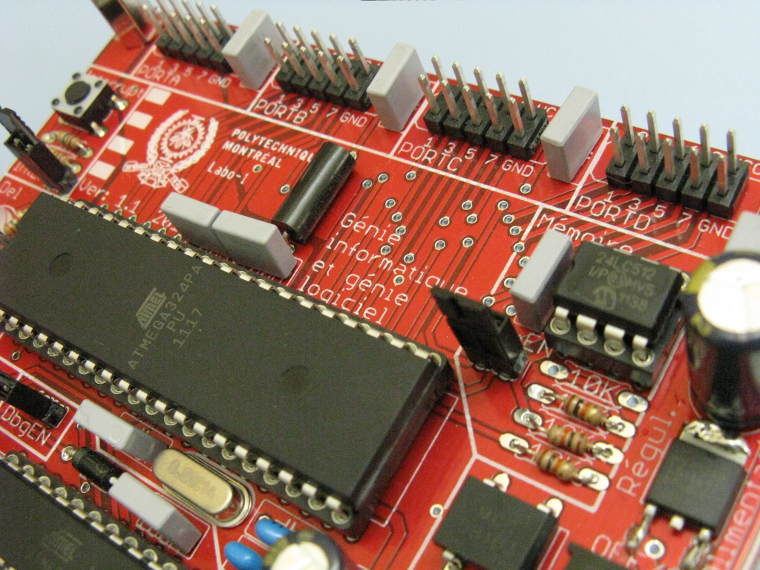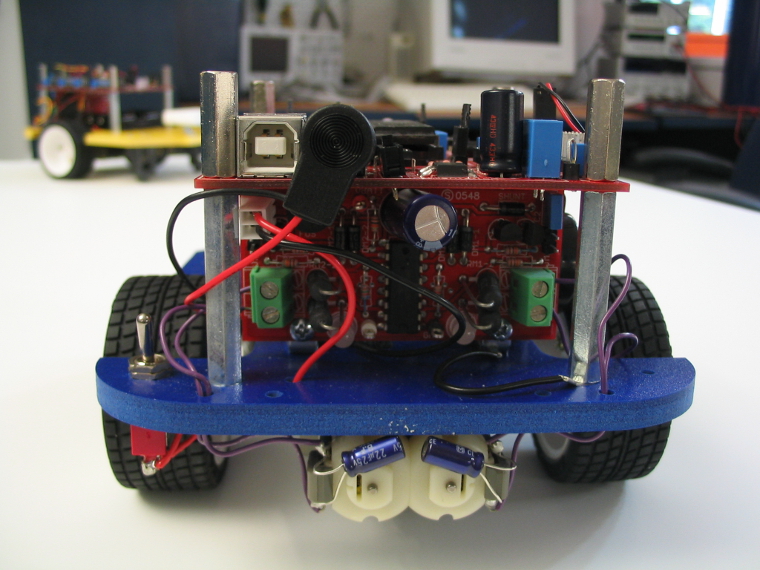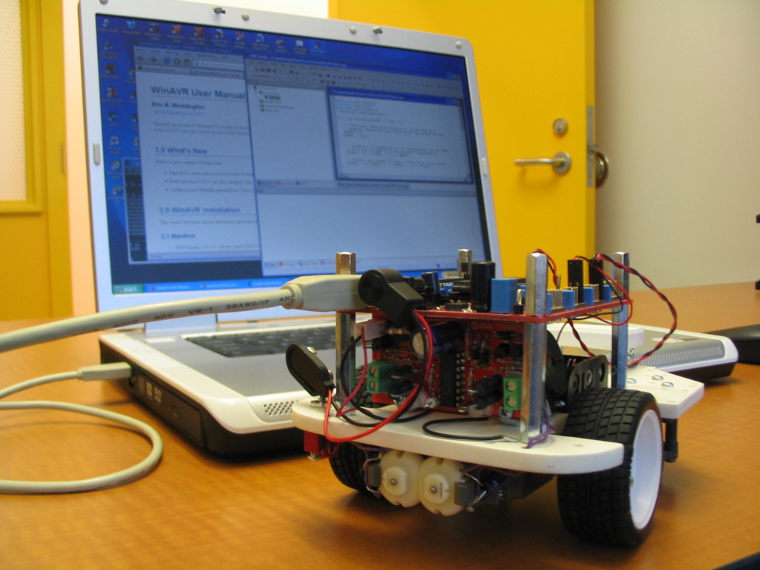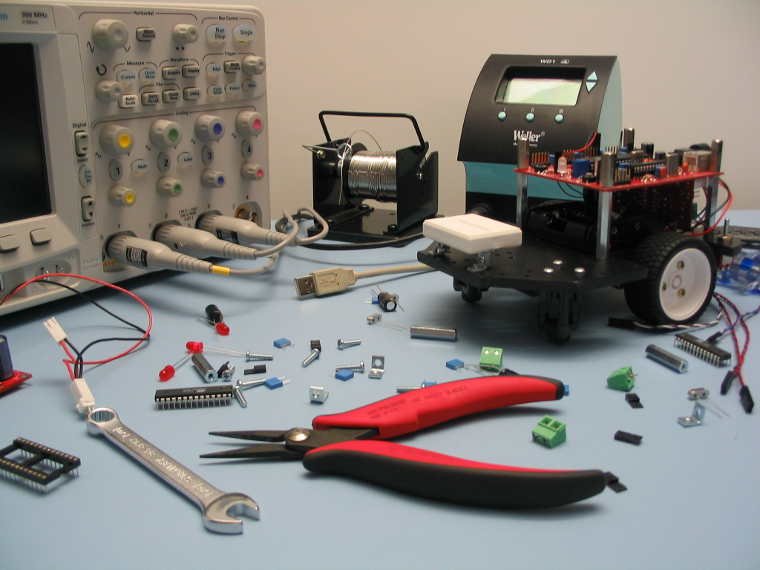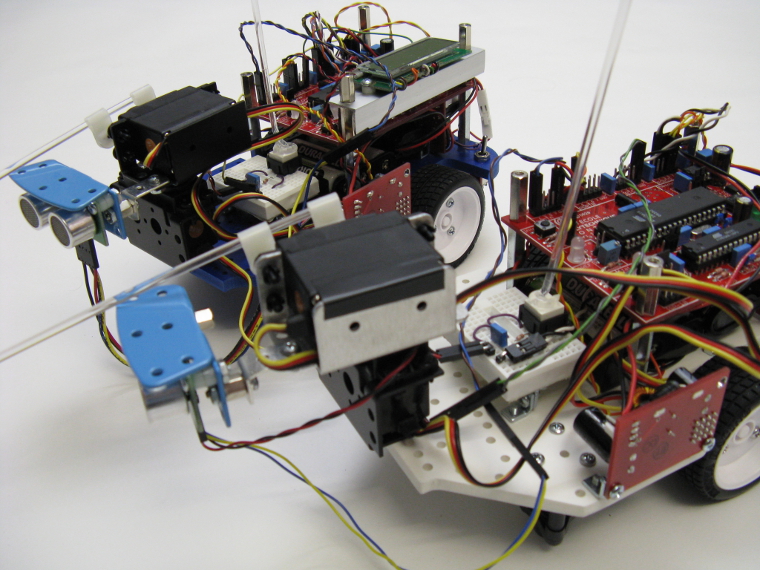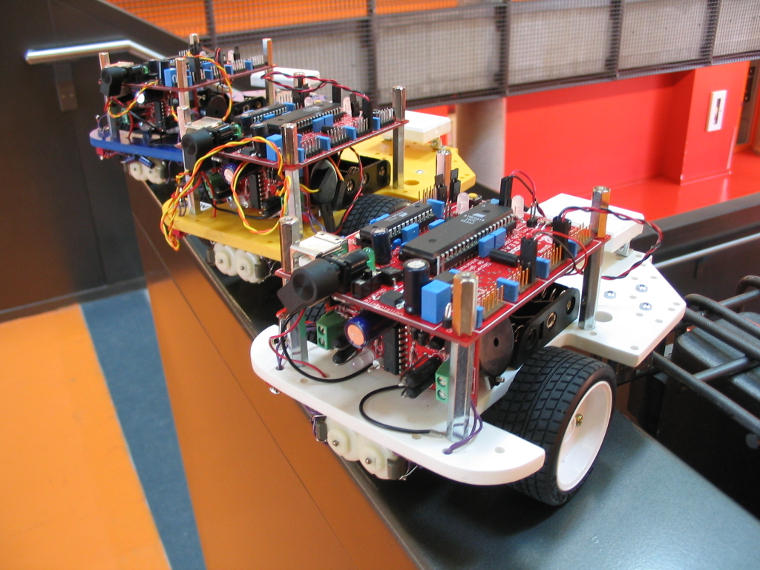Contacts
| Enseignants: |
Jérôme Collin, responsable (local M-4013, poste 5060) Geneviève Cyr (local M-4011, poste 3397) |
|
| Support technique supplémentaire: | Laurent Tremblay (local M-4008, poste 7181) | |
| Chargés de laboratoire: | Section 1: |
Gaëtan Florio (Lundi AM) Kais Fallouh (Mercredi PM) |
| Section 2: |
Laurent Bourgon (Mardi PM) Tristan Rioux (Jeudi AM) |
|
| Section 3: |
Raphaël Tremblay (Lundi PM) Nathan Bougie (Jeudi PM) |
|
| Section 4: |
Marc-Antoine Manningham (Mardi AM) Aymane Bourchich (Vendredi AM) |
|
| Section 5: |
Abdul-Wahab Chaarani (Mercredi AM) Meriam Ben Rabia (Vendredi PM) |
|